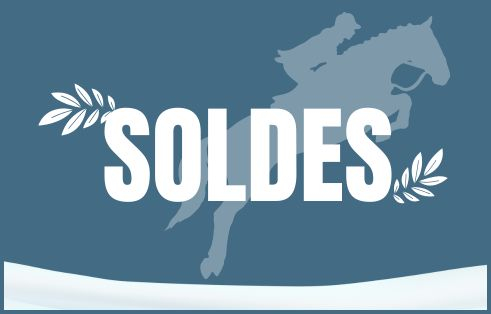Menu
Menu
-
MenuBack
-
Horse shop
-
-
FRENCH DAYS
-
-
EVENEMENTS
-
-
-
-
-
-
-
Forge Shop
-
-
-
-
-
-
OCCASIONS
-
-
-
- Horse Blog
- Forge Blog